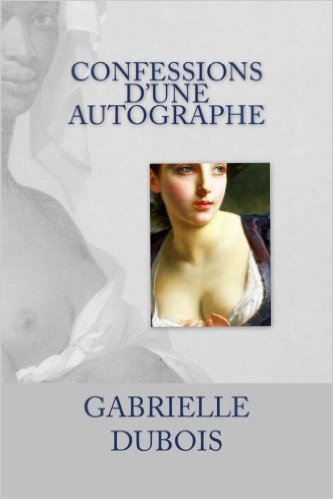
EXTRAIT de
Les confessions d’une autographe :
Tous droits réservés.
Chapitre 1
Le réfectoire de la deuxième chance
Le lycée Philippe le Bel, en plein cœur de Paris, sur les bancs duquel j’usais mes pantalons depuis un an déjà, avait pour élèves les rejetons de la crème de l’aristocratie française, ainsi que
quelques-uns des noblesses européenne et prussienne, celle dont je faisais partie. Comme chacun sait, je suis le deuxième et dernier fils du baron Alexandre von Lekkowski. Le jour de la rentrée
scolaire 1849, ce fut dans ce lycée que je rencontrai Marios Constantin pour la première fois.
Un an auparavant, après un séjour d’une année en Italie et en France avec ma tendre mère, séjour durant lequel j’avais été choyé et traité comme un prince que je pensais être, je n’étais guère
désireux de rentrer chez nous, en Prusse, où m’attendait un père dont je n’étais pas le fils aîné, et un frère aîné étrangement acariâtre et méchamment ambitieux. Je dis étrangement, parce que ce
frère, du point de vue du caractère, ne ressemblait en rien à nos parents, ni même à moi.
Le baron von Lekkowski mon père, passait la plus grande partie de son temps à la chasse, connaissant chaque bosquet de ses terres immenses, reconnaissant chaque cri d’animal à poils ou à plumes,
capable de remonter la piste d’un gibier à l’empreinte laissée dans la neige fraîche, à la feuille froissée sur l’arbre à son passage. Si je me joignais à lui avec plaisir dès que je rentrais
chez nous, je n’envisageais pas pour autant courir les bois à longueur d’année. Déjà un autre genre de chasse, en alcôve, avait ma préférence. Père aimait la nature.
À l’opposé de son mari, ma mère était une femme de salons. Musiciens, savants et écrivains formaient son petit cercle. Les deux conditions pour en faire partie, étaient d’avoir du talent et le
goût du rire. Mère aimait rire.
Ils avaient l’un pour l’autre, non pas cet amour fou que l’on rencontre dans les romans et que je n’ai rencontré qu’une fois dans ma vie, mais l’affection et la tendresse que peuvent parfois se
porter des époux de caractère doux, mariés par intérêt et qui, n’étant tombés amoureux ni dans le mariage, ni en dehors, prennent avec philosophie et bonheur le sort que la vie leur a
réservé.
Après nos pérégrinations sous le doux soleil italien, j’obtins, par retour de courrier, l’autorisation de mon père de rester à Paris pour finir mes études et laissai mère s’en retourner chez
nous. J’avais dix-sept ans. Oui, je sais, je n’étais pas bien en avance pour entrer en classe de seconde, mais ma scolarité avait été des plus décousues... nous y reviendrons.
Mon père loua donc pour moi un appartement petit, mais fort confortable, à l’hôtel des Trois Empereurs, place du Palais-Royal, mais il y mit plusieurs conditions. Je devais m’inscrire au lycée
Philippe le Bel pour y suivre les cours, ma conduite devait y être irréprochable afin qu’il n’eût pas à demander à notre ambassadeur d’intervenir pour moi auprès des autorités françaises. Enfin,
je devais lui envoyer, chaque trimestre, les félicitations de mes professeurs. Je remplis ces conditions. Je m’inscrivis dans ce lycée le plus prestigieux de la capitale, je n’y manquai aucun
cours, n’y fis pas de grabuge. J’oubliais seulement de travailler les mathématiques et les sciences pour lesquelles je n’avais aucune affinité. Quant au français, latin et grec, qui étaient
pourtant des langues que j’avais affectionnées jusqu’à ce jour, j’y consacrais si peu de temps, que je n’y brillais guère mieux. Par contre, à la fin de l’année, je dois avouer que j’excellais
dans une matière jusqu’alors inconnue de moi, mais bien souvent caressée en rêves : les femmes et leurs douces langues qui, elles, étaient bien vivantes.
À bout de patience, mon père m’ordonna de rentrer à la maison dès la fin des cours. Entièrement dépendant de son bon vouloir financier, j’obéis. Si je voulais retourner à Paris pour le premier
septembre suivant, je n’avais que quelques jours au mois d’août, si je décomptais l’aller et retour jusque chez nous, pour convaincre mon père. L’argument selon lequel j’étais devenu le jeune
homme le plus fashionable de la capitale française, je le savais, serait à proscrire, quand bien même être à la pointe de la mode n’est pas donné au tout venant. C’est au contraire un exercice
délicat qui nécessite un parfait équilibre entre les aptitudes innées qui sont de bonnes et belles dispositions physiques, et les acquises, qui sont de savoir devancer d’un soupçon les tendances
mais sans trop, pour ne jamais, au grand jamais, frôler le ridicule, et rester simple et aimable en toutes circonstances. Ce dernier point est toujours celui par lequel pêchent les jeunes
bellâtres qui affichent leur supériorité de don Juan blasé et par là-même, en deviennent détestables. Mais, bien évidemment, ce n’est pas à un père, tout bon qu’il fût, qui rentre crotté des
pieds à la tête d’avoir battu la campagne et heureux d’avoir traqué la bête sauvage en compagnie de garde-chasse et d’une bande d’hommes des forêts, que l’on peut exposer ce genre d’évidences
stylistiques, ô combien indispensables à la vie de patachon d’un jeune citadin.
J’avais aussi acquis, pendant cette douce année, une verve, une aptitude à fasciner mon auditoire par des mots choisis avec aisance et débités avec facilité. Je me rends compte aujourd’hui que
mon public habituel était du genre féminin et facile, et ne demandait qu’à se laisser hypnotiser. Il faut dire que j’ai été gâté par la nature. Quand on a la taille svelte et les épaules bien
développées, entretenues dans une salle d’arme, un visage fin et régulier, de beaux yeux bleus et les plus soyeuses boucles blondes, on a bien peu d’effort à fournir en matière de discours. Je
n’étais pas aveugle sur moi-même au point de penser que ce genre d’atouts pouvait faire le poids face à tout le monde, et j’entends par là, mon père ou M. Dumollet, notre proviseur, homme à
manier avec des pincettes.
Quelques mots ici sur M. Dumollet. Cet homme malingre au crâne ovoïde était un simple roturier sorti de nulle part, mais arrivé là certainement grâce à un entêtement hors du commun. Il avait une
finesse d’esprit digne d’un prince de la plus grande lignée, mais des habitudes de bourgeois, ou devrais-je dire, de coucou suisse. Chaque premier jour des vacances, vous pouviez le voir à la
gare, avec femme et enfants, partir dans sa belle-famille, à Saint-Malo. La veille, au détour d’un couloir ou en cour de récréation, il ne manquait pas d’entendre chanter, dans son dos, ce
refrain populaire et joyeux :
« Bon voyage, monsieur Dumollet,
À Saint-Malo débarquez sans naufrage ! »
J’étais si convaincu d’être irrésistible, qu’avant de quitter le lycée, je mis à l’épreuve mes talents d’orateur alors que j’étais convoqué par le proviseur qui me tint à peu près ce discours
:
- Lekkowski, je ne vous cache pas qu’à vous seul et ce, malgré les avertissements répétés de vos professeurs, vous avez été, cette année, pour tous nos élèves, un déplorable exemple. Non
seulement vous n’avez pas travaillé, mais encore, vous avez dissipé plus d’un de vos camarades.
- Monsieur Dumollet, telle n’était pas mon intention, je vous présente mes humbles excuses.
- Elles arrivent bien tard.
- Mais pas trop tard ?
- Le résultat de votre conduite, jeune homme est que personne ici n’est content de vous et j’ose espérer que vous ne l’êtes pas vous-même.
- Bien sûr que non, monsieur. Mais il y a bien un professeur qui ne soit pas totalement insatisfait de moi ?
- Un seul, oui. Votre professeur de français qui vous a défendu mieux qu’un avocat ne l’aurait fait. Il prétend que vous en valez la peine. Mais nous ne le saurons pas, puisque vous n’allez pas
vous réinscrire l’année prochaine, ce qui vous évitera la honte d’être renvoyé aujourd’hui-même.
J’affichais un air calme et détaché dont je me félicitais, mais intérieurement, je n’en menais pas large :
- Monsieur, je plaide coupable. Je n’ai effectivement pas travaillé et j’ai invité quelques-uns de mes camarades à des soirées.
- Ah ! Vous avouez enfin, Lekkowski ! Alors que je vous ai déjà convoqué deux fois dans ce bureau sans jamais obtenir de vous que vous fassiez amende honorable, ni même une quelconque
amélioration de votre conduite.
- Coupable je le suis, certes, mais laissez-moi plaider ma cause auprès de vous, monsieur. Ce que vous m’avez dit jusqu’à présent est tout à fait juste. Aussi, je pense pouvoir attendre de vous,
une fois que vous m’aurez écouté, la plus grande justice.
- Pourquoi pas ? J’ai dix minutes devant moi, nous sommes en juillet et j’ai moi aussi envie de me divertir un peu. Je vous écoute, dit-il, finaud, en s’adossant à son fauteuil et croisant ses
mains sur son gilet.
- Je vous remercie, monsieur Dumollet. C’était mon choix d’étudier à Paris, capitale dont la pensée éclairée rayonne sur le monde. Père a eu la générosité de m’offrir son soutien financier pour
que je puisse vivre ici, dans ce pays de progrès, de droit et d’équité. Fait que j’ai méprisé, pensez-vous, comme un enfant gâté. Ai-je gâché mon année ? Bien au contraire, monsieur, je puis vous
l’assurer. Le remords me taraude quand je pense à cet extraordinaire privilège que j’ai pris comme un dû, alors que j’aurais dû le recevoir comme la récompense anticipée d’un mérite. Mais vous
connaissez la jeunesse mieux qu’elle ne se connaît elle-même, monsieur Dumollet. Si j’ai appris une chose, c’est que je ne suis pas le genre d’homme à pouvoir vivre avec un remords et cela
m’incitera, à l’avenir, à réfléchir avant d’agir afin de ne pas retomber dans les mêmes tourments.
- Vous pourriez être divertissant, Lekkowski, dit-il en réprimant un bâillement vrai ou feint, mais vous êtes à la limite de l’ennuyeux. Venez-en au fait, je vous prie.
S’il croyait me désarmer avec ces petits stratagèmes, il se trompait bien :
- J’y viens, monsieur. Loin de moi l’envie de vous faire bailler, je n’ai qu’un désir, vous faire juge de ma misère. Je plaide coupable d’avoir eu une trop grande confiance en mes capacités à
vivre seul, loin de ma famille, loin de ma chère maman. Coupable d’avoir eu la faiblesse, pour pallier ce manque d’affection d’enfant exilé, de m’entourer d’élèves que, vous noterez monsieur,
j’avais pris soin de ne choisir qu’en dernière année pensant qu’ils étaient capables de juger par eux-mêmes si soutenir la solitude d’un ami les détournerait ou non de leurs devoirs.
M. Dumollet sourit :
- Et vous pensez qu’un tel plaidoyer me suffira pour vous donner une deuxième chance, Lekkowski ?
- Je vois bien que non, monsieur et j’en comprends la raison : vous avez trop d’esprit pour qu’un élève, quand bien même il aurait mon potentiel, puisse influer sur votre décision. D’un autre
côté, le fait que je n’ai pas atteint le niveau qui me permettrait de soutenir une conversation face à vous sans paraître trop ridicule, prouve bien que j’ai besoin, plus que quiconque, que vous
me laissiez me réinscrire dans votre prestigieux établissement dont l’enseignement est le seul qui pourra faire de moi un être capable de raisonnement, tels que vous aimez en voir sortir, chaque
année, du lycée Philippe le Bel.
- Je constate que tel le chat, vous avez l’art de retomber sur vos pattes, mais qu’attendez-vous de moi, exactement ?
- Autant de clémence que celle que mon père aura à mon égard, quand je vais rentrer chez nous, en août, pour subir ses récriminations justifiées et le supplier à genoux de me laisser finir mes
études chez vous, monsieur Dumollet. J’ajoute que s’il y a une quelconque pénitence que vous jugiez nécessaire de m’infliger, je m’y soumettrai, ce ne serait que justice.
- Vous êtes intelligent, Lekkowski, aussi vais-je me montrer direct avec vous. Voici ce que je vous propose : si vous rameniez de chez monsieur votre père, non seulement de la clémence à votre
égard, mais une contribution au réaménagement de notre réfectoire, je pense pouvoir vous garder une place jusqu’à la fin du mois d’août.
- Merci, mons...
- Attendez ! Je n’ai pas fini. À cela, j’ajoute une condition. Voyez-vous, des noceurs comme vous, qui pensent que la vie se résume à l’esthétique de la frisure d’une moustache ou à l’élégance
avec laquelle ils portent un costume, des jeunes gens qui se considèrent des maîtres en rhétorique parce qu’ils ont su étourdir, par quelques vagues mots bien tournés, volés aux grands poètes,
des femmes qui se seraient laissées séduire à moins ; des fils de bonne famille qui n’ont d’autre centre d’intérêt que les amusements légers, j’en ai vu passer. Ils ne guérissent pas.
- J’ai bien l’intention...
- Je ne veux rien savoir de votre vie en dehors d’ici, vous en êtes le maître. Mais ici, c’est moi, le maître. Le maître absolu. Le moindre manquement que ce soit, en cours, au travail donné ou à
la discipline, et je vous mets dehors, monsieur von Lekkowski, tout baron que vous êtes et ce, même en cours d’année, alors que vos camarades eux, continueront à déjeuner dans le réfectoire
flambant neuf que vous leur aurez offert.
- Bien sûr...
- Je vous arrête là ! Ne promettez rien, ne me servez plus aucun de vos piètres raisonnements. Nous nous reverrons peut-être le premier septembre, lors de mon discours de bienvenue, mais ce sera
tout. Je ne veux plus jamais vous voir dans mon bureau, assis en face de moi sur cette chaise. Est-ce bien clair ? Si oui, saluez et sortez, monsieur von Lekkowski.
- Au revoir, monsieur Dumollet, lui dis-je.
Avant de passer la porte de son bureau, je lui lançai un joyeux :
- Bon voyage, monsieur Dumollet !
Le proviseur grommela en replongeant dans sa paperasserie administrative, mais son œil brillait, songeant certainement au nouveau réfectoire qu’il venait d’obtenir si facilement.
Pour mon père, que j’étudie là ou ailleurs ou pas du tout, n’avait aucune espèce d’importance. Il ne voyait pas l’intérêt de savoir le latin pour entrer dans l’armée, ce qui était mon destin
depuis toujours. Alors que nous dînions en compagnie de ma mère, il s’exclama, un grand sourire aux lèvres :
- Très bien, Maximilian ! Serais-tu encore capable de porter un fusil ou tes muscles ont-ils fondu au point de ne pouvoir porter qu’une plume et un cahier ?
- Vous ne seriez pas mon père, répondis-je, vexé, que je vous aurais demandé réparation de cette injure !
- Tu as l’air bien sûr toi, l’étudiant ! Partons à la bécasse demain. Celui qui en ramène le plus décide de ton avenir.
- Père, je ne dis pas que je n’accepterais pas une mise à l’épreuve, ou que je manque de courage pour relever un défi, mais celui-ci est perdu d’avance pour moi. Je n’ai pas tiré depuis plus d’un
an et la chasse est toute votre vie. Mais si c’est ce que vous demandez, je m’y plierai.
- Je n’ai jamais été injuste envers qui que ce soit, pas même envers un jeune blanc-bec dont la cravate est plus volumineuse que le jabot d’un coq !
L’air de rien, du plat de la main, je tentai d’aplatir ma cravate.
- Si tu ne veux plus que je décide de ton avenir, Maximilian, c’est donc que tu te penses supérieur à moi. Prouve-le moi !
- Que suggérez-vous, père ?
- Un duel.
- Alexandre ! s’écria ma mère, vous n’y pensez pas !
- Avec un gilet pour contenter la baronne, fils. Le premier qui touche au cœur a gagné.
- Même ainsi je vous l’interdis, messieurs ! Vous n’allez tout de même pas faire couler le sang pour une histoire de lycée !
- J’accepte, père, annonçai-je, en lui tendant la main qu’il serra.
- Prépare ton paquetage pour l’armée, fils !
- Préparez votre bourse pour mon inscription, père.
- Faites cela et je vous ôte ma tendresse à tous les deux, dit mère.
Père lui sourit et prit sa main :
- Nous verrons cela demain. En attendant, ma très chère, vous en aurez bien un peu pour moi ce soir, j’espère ?
Mère rougit et se leva :
- Des rustres, voilà ce que vous êtes ! s’exclama-t-elle, sans arriver à se fâcher vraiment.
Il m’en coûta une jolie estafilade au bras, mais je touchai père au cœur le premier. Il s’inclina et j’obtins une année de plus à Paris. Ce qui me surprit le plus lors de ce séjour chez moi, fut
le soutien de mon frère, lui qui ne m’avait jamais montré qu’une fraternelle jalousie. Je ne comprendrai son objectif que trop tard. Insouciant et donc heureux, je reprenais ma route vers la
France, sans savoir que cette rentrée 1849 me réservait un inestimable cadeau : un ami..."






